
Stations de dépistage auditif – Témoignage Crédit Mutuel
Beatrix Dumas, je travaille au sein de la DRH du Crédit Mutuel du Sud-Est depuis 7 ans. Mon action englobe plusieurs aspects : l’intégration de
En open space, le bruit n’est pas un simple inconfort : il pèse sur la concentration, la coopération et la QVCT. 52 % des actifs se disent gênés par le bruit au travail et 70 % prêts à agir pour le réduire. Dès maintenant, vous pouvez poser un bilan simple, clarifier des règles d’usage, outiller l’équipe et, si nécessaire, choisir des aménagements utiles. Comment mieux gérer le bruit en open space pour gagner à la fois en bien-être et en productivité ? Suivez notre méthode en 5 étapes pour engager des résultats concrets.

Avant de parler règles, habitudes ou aménagements, commencez par faire une cartographie de la situation en open space pour y voir clair. En une semaine, vous allez réaliser ce qu’il se passe vraiment dans votre open space : un bilan partagé, factuel et utile pour vos démarches QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail)
Pendant 5 jours, relevez le niveau sonore à trois moments (matin, début d’après-midi, fin de journée) au même point des différentes zones de l’open space, 5 minutes à chaque fois. Ce journal de vos mesures vous permettra d’avoir une tendance concernant les nuisances et obtenir une moyenne en décibels du niveau de bruit :
Utilisez une application de mesure du bruit ou un petit sonomètre. Vous recherchez une tendance générale, pas un audit. L’objectif de ces mesures est d’avoir une représentation fidèle des situations récurrentes et réelles, utile pour le bien-être, la santé au travail et la productivité.
À noter : Si vous souhaitez obtenir des mesures plus approfondies sur les environnements de travail bruyants, il existe des agences spécialisées qui peuvent se rendre dans vos locaux pour effectuer les mesures nécessaires et dresser un bilan complet.
Pourquoi est-ce important dans le cadre de la QVCT ? Parce que le bruit perturbe d’abord la concentration et la coopération, qui conditionnent la productivité. Des mesures simples et partagées coupent court aux impressions ‘à chaud’ : elles posent une base factuelle, comprise par tous, pour décider calmement de la suite.
Transformez vos constats en tableau simple et lisible. Croisez vos zones et vos créneaux (zones de travail / matin, début d’après-midi, fin de journée). Utilisez un code couleur, (vert/jaune/rouge) pour quantifier le niveau de gêne observé (faible/moyenne/forte) en vous appuyant sur vos mesures et vos notes de contexte.
Exemple :
But de la cartographie : montrer où et quand agir en priorité sans détailler encore les actions (elles viennent plus loin).
Les décibels ne disent pas tout. Complétez vos mesures par un questionnaire anonyme avec des questions centrées sur : les tâches impactées par le bruit, les moments trop bruyants, les interruptions typiques et les solutions déjà appréciées par les collaborateurs. Fixez un délai de 72 h et visez plus de 70 % de réponses pour que le bilan soit pertinent et fiable.
Pensez aussi aux études nationales pour guider vos questions : 31 % des actifs se disent gênés par les conversations entre collègues et 34 % par les bruits extérieurs.
Pour aller plus vite, appuyez-vous sur le questionnaire SONUP SoCiety et comparez vos résultats aux tendances citées.
Idée : Vous pouvez aussi mettre en place une boite à idée anonyme. Vos collaborateurs pourront glisser à l’intérieur les moments qu’ils trouvent les plus gênants, mais aussi leurs idées d’amélioration. Cela leur permettra de se sentir impliqués et écoutés.
Si des collaborateurs expriment une gêne persistante, proposez un dépistage auditif à titre préventif. C’est une action QVCT à fort effet de levier, d’autant que 78 % des actifs n’en ont jamais bénéficié en entreprise.
À la fin de la semaine, votre bilan reprendra en 1 page :
Avec ce trio, vous savez où, quand et pourquoi le bruit en open space pose problème et vous posez des bases solides mettre en place des actions correctives.
À noter : le bruit en open space n’a pas d’impact direct sur l’audition, mais plutôt sur l’état de santé global des collaborateurs (stress, fatigue, etc).
Avec des règles d’usage claires (où, quoi, comment), le bruit en open space diminue rapidement. Inutile de tout changer tout de suite : on commence par un cadre simple, visible et partagé, qui réduit les nuisances sonores open space au quotidien.
Commencez par nommer clairement trois espaces :
Donnez-leur des noms explicites et ajoutez une signalétique à l’entrée de chaque zone : en un regard, on comprend la règle.
Si l’open space est trop réduit, définissez des plages dédiées :
L’idée est simple : caler des créneaux adaptés pour fluidifier la journée sans tension.
La charte pose les règles de vie communes. Elle doit être courte, bienveillante et actionnable. Idéalement, rédigez-la avec les collaborateurs lors d’un court atelier (20–30 minutes) :
Voici un exemple de brouillon à adapter à vos usages :
Pour favoriser l’adhésion et l’application de la charte : affichez-la dans chaque zone et proposez un mémo visuel au poste de travail (petit format “rappel des 8 points”). Un QR code peut renvoyer à la version complète.
Objectif : rendre ces règles visibles et faciles à suivre au quotidien, sans ajouter de lourdeur.” Voici quelques leviers pour vous accompagner :
Avec une organisation claire et une charte co-construite, les appels au poste de travail diminuent, les interruptions se font plus rares et chacun retrouve des repères stables. Vous créez une culture de respect sonore au service du bien-être, de la santé au travail et de la productivité.
Après les règles et l’organisation des espaces, place aux gestes concrets qui réduisent le bruit en open space sans alourdir la journée. L’idée est d’instaurer quelques routines simples, côté collaborateurs et managers, pour limiter les nuisances sonores open space et protéger l’attention.
Le cœur du sujet, c’est la gestion des interruptions. Plutôt que de multiplier les micro-interruptions, regroupez ce qui peut l’être et préparez ce qui doit l’être.
En pratique, trois réflexes suffisent :
Ces habitudes permettent de réduire les sources de dispersion en open space.
Résultat : moins de brouhaha, plus d’efficacité — et des nuisances sonores en open space naturellement contenues.
Côté managers/RH, l’enjeu est d’offrir des repères simples. Deux leviers pour vous aider :
Ces deux choix font diminuer les interruptions qui finissent par alimenter le bruit en open space.
Seuil de risque : 80 dB(A) sur 8 h d’exposition.
L’équipement n’est pas une solution miracle ; il complète les bonnes habitudes et les règles d’usage.
L’idée générale : d’abord des habitudes claires et partagées, ensuite un équipement choisi pour servir ces habitudes — pas l’inverse. C’est ce trio (règles, routines, outils) qui protège durablement le bien-être et la productivité.
L’aménagement vient après la définition des règles et des habitudes. Il traite ce que les étapes 1 à 3 ont mis en lumière : où, quand et pourquoi le bruit en open space gêne. L’objectif n’est pas de tout transformer, mais de résoudre un besoin précis au service de la QVCT.
Avant de regarder des solutions, posez une question simple : quel problème voulez-vous résoudre ? Voici quelques objectifs fréquents :
À partir de votre bilan (Étape 1), choisissez un besoin prioritaire et concentrez-vous dessus. Mieux vaut résoudre un point bien ciblé que disperser les efforts.
Sans entrer dans la technique, voici des repères de choix pour gérer l’acoustique en open space :
En résumé : une cloison acoustique sert à délimiter un usage et freiner la voix qui passe d’un espace à l’autre. Les panneaux/traitements absorbants servent à atténuer la réverbération et le brouhaha.
On peut combiner les deux selon l’objectif prioritaire.
Ces pistes ne sont pas exclusives : on peut combiner une solution pour les appels avec quelques panneaux absorbants. L’essentiel est de rester cohérent avec l’objectif défini et de tester avant de déployer plus largement.
Un aménagement fonctionne si chacun sait comment l’utiliser.
Quelques règles suffisent, clairement affichées là où elles s’appliquent.
Pour une cabine d’appels / une salle d’échanges de courte durée
Pour des espaces distincts séparés par des cloisons acoustiques
Pour les panneaux/rideaux absorbants
L’aménagement n’est qu’un levier parmi d’autres. Pour avancer sereinement, vous pouvez vous appuyer sur un accompagnement dédié.
SONUP SoCiety propose des actions de prévention, sensibilisation au bruit et dépistage auditif pour les collaborateurs qui le souhaitent. L’idée est d’aider les collaborateurs à relier aménagement, bien-être, santé au travail et organisation du quotidien dans la durée.
Cette dernière étape transforme vos efforts en résultats durables. Il s’agit de vérifier, mois après mois, si les actions engagées réduisent bien le bruit en open space, soutiennent la concentration et facilitent le travail d’équipe. Pas besoin d’un tableau de bord compliqué : quelques repères simples, toujours les mêmes, suffisent.
Conservez les mêmes points de mesure que lors du bilan (Étape 1) pour pouvoir comparer.
Astuce : regroupez ces données sur un document “Tableau de bord QVCT – Sonore” (type excel ou Google Sheet) et conservez l’historique d’un mois à l’autre en ajoutant les données du mois en cours dans un nouvel onglet. La tendance compte plus que le chiffre isolé.
Pour juger de l’effet réel, comparez votre analyse du mois en cours avec celle du point de départ :
Si un indicateur stagne, ne vous dispersez pas. Choisissez une seule cause visible et un seul levier à ajuster, puis retestez.
Exemple : le créneau début d’après-midi au Pôle Support reste tendu. Action unique : prolonger la plage de concentration de 30 minutes et rappeler une règle d’usage sur les appels. Durée de test : 2 semaines, puis re-mesure sur les 4 indicateurs.
À qui s’adresse ce rendez-vous ?
Format court, toujours le même (15 minutes, pas plus)
Ce rendez-vous installe une routine d’amélioration continue : vous suivez la tendance, vous ajustez sans lourdeur, et vous ancrez durablement un cadre qui soutient le bien-être, la santé au travail et la productivité face au bruit en open space.
Réduire le bruit en open space se joue au quotidien : un bilan partagé, des règles d’usage claires, des habitudes réalistes, puis des aménagements ciblés quand c’est utile. Avec un rendez-vous QVCT régulier, vous suivez la tendance, vous ajustez sans lourdeur et vous gagnez en attention, en coopération et en efficacité. Prêts à passer à l’action ? Lancez votre bilan, finalisez votre charte en open space et choisissez une amélioration pour le mois prochain. Besoin d’un appui en complément pour mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation. Contacter SONUP SoCiety.
Autres articles :

Beatrix Dumas, je travaille au sein de la DRH du Crédit Mutuel du Sud-Est depuis 7 ans. Mon action englobe plusieurs aspects : l’intégration de

Vous ressentez une sensation désagréable dans l’oreille depuis peu ? Vous avez l’impression de moins bien entendre votre entourage ? Votre oreille est possiblement bouchée.
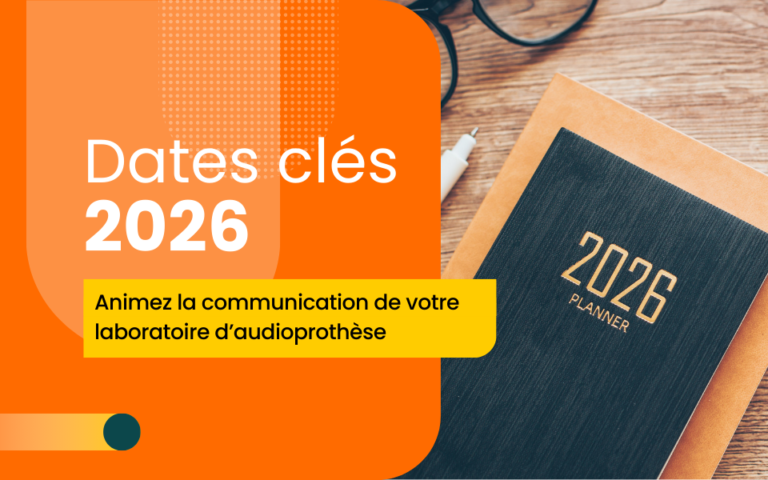
Pour vous faire gagner du temps, SONUP a regroupé les principales “dates marronniers” liées à l’audition, à la santé et à l’accompagnement qui peuvent servir
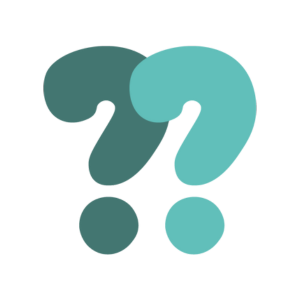
Trouvez des réponses à vos problématiques individuelles en échangeant avec un référent en audition.

Faites le point tout de suite sur votre audition grâce à un test en ligne rapide & fiable

Trouvez un professionnel de santé près de chez vous pour effectuer un bilan auditif complet.