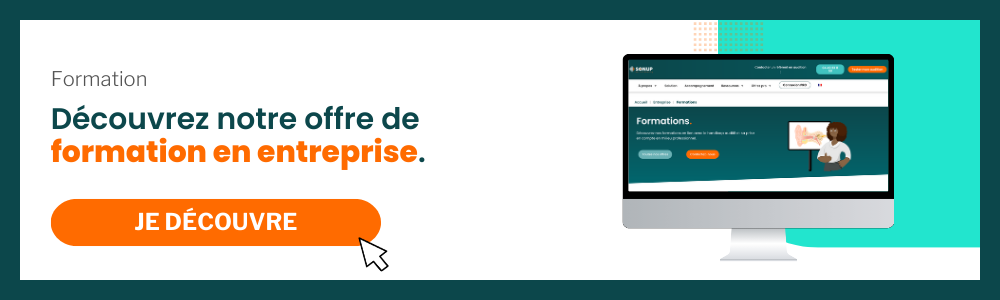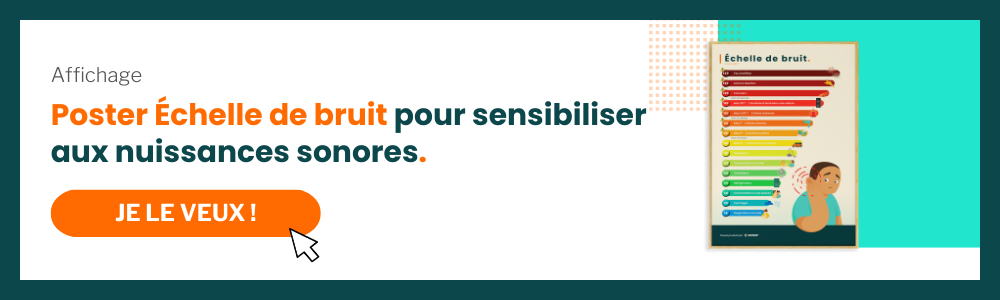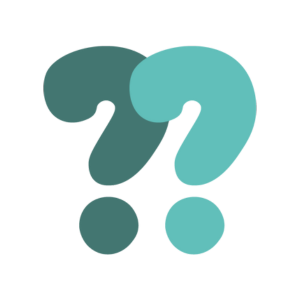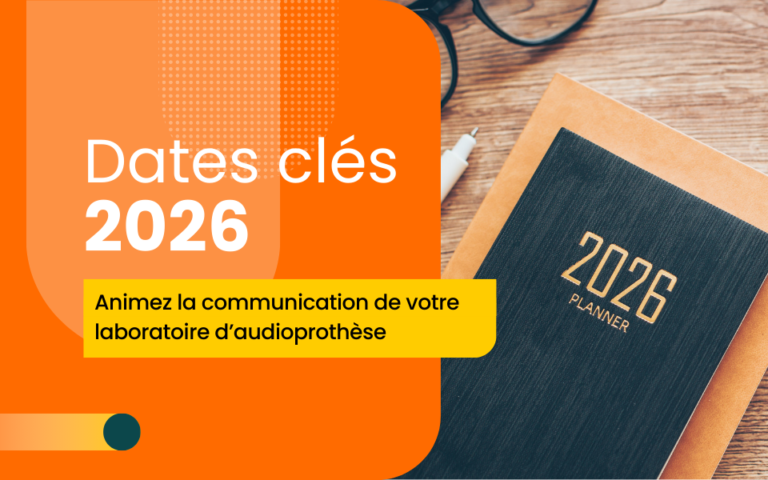
Dates clés 2026 : le calendrier pour animer la communication de votre laboratoire d’audioprothèse
Pour vous faire gagner du temps, SONUP a regroupé les principales “dates marronniers” liées à l’audition, à la santé et à l’accompagnement qui peuvent servir